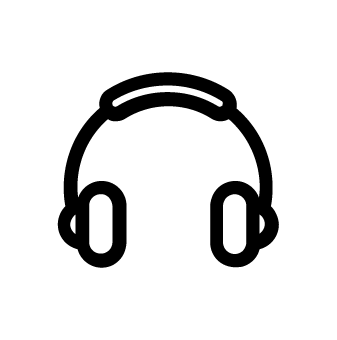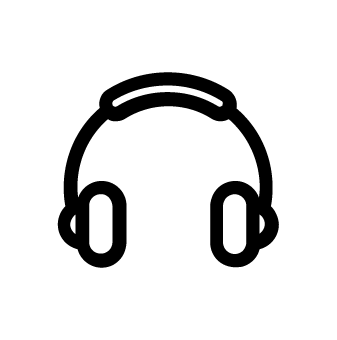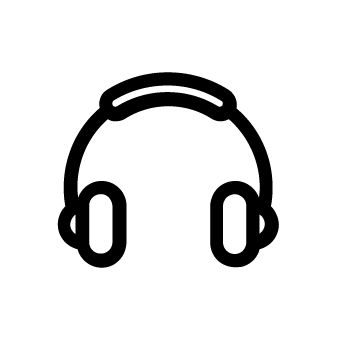Page découverte
La Grande Guerre (3) Le conflit

Le début de la guerre, le 3 août 1914, marque l’arrêt de toute activité artistique et la fermeture pour plusieurs mois des théâtres, cafés-concerts et music-halls. Les Français, galvanisés par la propagande belliciste et l'esprit d’Union sacrée pour défendre la patrie, ont mis de côté leurs différends politiques… Face aux Allemands, présentés comme des barbares, la mobilisation des hommes et des esprits est devenue un enjeu national. Le chansonnier Montéhus lui-même se met au service de la cause en écrivant des chansons sur et pour les poilus, où demeure tout de même une approche humaine : Le Train des conscrits, C’est un poilu, La Voix des mourants, Le Mutilé, La Dernière Victime, etc.
Les chantres de l’Union sacrée
Théodore Botrel, le barde breton patriote, a toujours cultivé l’esprit nationaliste et connaît un grand succès avec la revue qu’il dirige, La Bonne Chanson. Il signe de nombreux couplets de circonstance : La Crève aux Boches, Au Front, Dans la Tranchée, Pour la Patrie, Les Coqs d’or, etc. ; il les publie dans des recueils comme Les Chants du bivouac puis Chansons de route et Coups de clairon. D’autres chansonniers parisiens consacrent des séries de refrains à l’actualité de la guerre. C’est le cas de Lucien Boyer avec La Guerre en chansons, d’où est tirée Au Bois Leprêtre, écrite en 1915 sur l’air à succès d’Aristide Bruant Belleville-Ménilmontant : décrivant le quotidien des poilus qui, durant de longs mois, affrontent les Allemands dans l’est de la France, cette chanson est créée à Paris, au Théâtre du Gymnase, par Jane Pierly.
Tandis que la guerre s’enlise dans les tranchées, le théâtre aux armées s’organise à partir de 1915 et les artistes partent distraire les soldats. Ils chantent sur les scènes de fortune dressées dans les cantonnements situés à l’arrière du front, là où les soldats viennent en repos après une semaine de combat dans les tranchées. C’est devant les poilus que le comique troupier Bach rencontre le succès avec Quand Madelon, passée inaperçue à Paris avant la guerre ; à présent, cette chanson fait écho à l’attente des soldats qui manquent singulièrement de compagnie féminine… Parmi les habitués de ces scènes, Théodore Botrel devient une sorte de chansonnier officiel des armées. Après avoir vanté les mérites de la baïonnette surnommée « Rosalie », il signe en octobre 1915 un hymne à la mitraillette : Ma P’tite Mimi, écrite sur l’air du vieux succès de Vincent Scotto La Petite Tonkinoise ; les paroles, filant la métaphore grivoise, en sont assez surréalistes.

Le conflit s’éternise et, à partir de l’automne 1915, des permissions de huit jours sont instaurées pour les combattants, qui peuvent ainsi revoir leur famille ou se distraire à Paris. En 1916, la guerre entre dans sa phase la plus meurtrière avec l’interminable bataille de Verdun, suivie par celle de la Somme. Les chansons patriotiques constituent alors l’essentiel du répertoire officiel : Hardi les Gars !, L’Aigle et le coq, Verdun, on ne passe pas !, etc. De leur côté, les poilus parviennent à publier des journaux de tranchées pour distraire les camarades. On y trouve des dessins, des histoires, des poèmes et parfois des chansons écrites par les soldats eux-mêmes sur des airs connus : ils décrivent mieux que personne la réalité de leur vie au front.
Du consentement aux mutineries
À l’arrière, l’optimisme reprend le dessus et l’on danse à nouveau dans des bals privés et clandestins. Les music-halls font salle comble, notamment grâce aux permissionnaires français et alliés. Un fossé d’incompréhension se creuse pourtant entre deux réalités : le front et l’arrière. Écœurés par ce décalage, incapables d’exprimer leur expérience des combats, les poilus préfèreraient presque rester sur le front… Dans leur immense majorité, ils ne manquent ni de courage ni de patriotisme. Ils ont le sens du devoir et du sacrifice, mais il est des circonstances où ils finissent par refuser les ordres : lorsque les combats entraînent de lourdes pertes pour un résultat insignifiant – souvent quelques mètres regagnés.

Durant la bataille de Lorette (en Artois), fin 1915, des paroles séditieuses commencent à circuler dans les tranchées. Écrites sur l’air d’une romance sentimentale d’avant-guerre, Bonsoir m’amour, elles expriment, non pas une envie de désertion, mais un ras-le-bol de soldats vis-à-vis de leur commandement incompétent et surtout des puissants embusqués à l’arrière qui laissent les pauvres se sacrifier sur le front. Ces paroles circuleront ensuite par le bouche à oreille jusqu’à Verdun en 1916, puis à Craonne en avril 1917, au moment de la terrible offensive du Chemin des Dames lancée par le général Nivelle, sans grand résultat. Les mutineries de soldats démoralisés qui s’ensuivent sont réprimées durant l’été : une cinquantaine de mutins est fusillée pour l’exemple. Des lettres de poilus alors saisies par la police font référence à cette Chanson de Craonne. L’État-major offrira en vain une récompense pour retrouver son auteur…
Une victoire provisoire
L’entrée en guerre des États-Unis en avril 1917 permet de modifier l’équilibre des forces en faveur des alliés, et le retour de Clemenceau à la présidence du Conseil est décisif au plan stratégique. Malgré les offensives allemandes de 1918 qui visent particulièrement Paris, le territoire français est progressivement reconquis. Le conflit le plus meurtrier de l’histoire s’achève le 11 novembre 1918 par la défaite de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie, au prix de pertes immenses dans les deux camps : près de 19 millions de morts au total, militaires et civils confondus, et 21 millions de blessés, sans compter les destructions colossales. L’armistice est fêté par La Madelon de la Victoire, chanson créée par Maurice Chevalier dans son tour de chant au Casino de Paris.

Une frénésie de danse s’empare alors de toutes les salles de spectacle. En cinq ans, des fortunes ont changé de mains et les plus chanceux n’ont plus qu’une idée : s’amuser. C’est le début des « années folles » qui connaîtront un foisonnement artistique exceptionnel. Mais cette image insouciante ne concerne en réalité qu’une population restreinte de jeunes Parisiens. À travers le pays, c’est la désolation qui domine : chaque village édifie son monument aux morts, les rues sont peuplées de veuves portant le deuil et de mutilés. Les survivants n’ont qu’une exhortation à la bouche : « C’était la der des ders » ou bien « Plus jamais ça ! ». Hélas, le traité de paix signé à Versailles en 1919, très dur envers les vaincus, porte en lui les germes d’une nouvelle guerre, et les enfants des poilus connaîtront vingt ans plus tard un second conflit tout aussi terrible.
Auteur : Martin Pénet